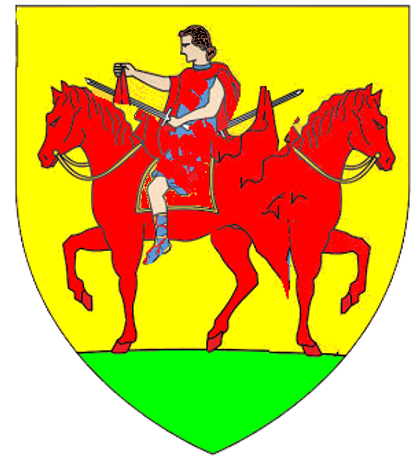
Plus de quarante ans après la disparition d'un
cinéaste mythique, le lecteur découvre avec émotion et respect ce témoignage d'un de ses
héritiers rebelles. Dans l'heureux soir de sa vie, Yoshida se souvient, voudrait ordonner ces souvenances,
mais ne peut se retenir de les entrecroiser, tout comme un capricieux montage ozuesque introduirait, dans
un fil narratif banal, des décors vides, des accessoires qui n'en sont pas, des regards d'arbres.
